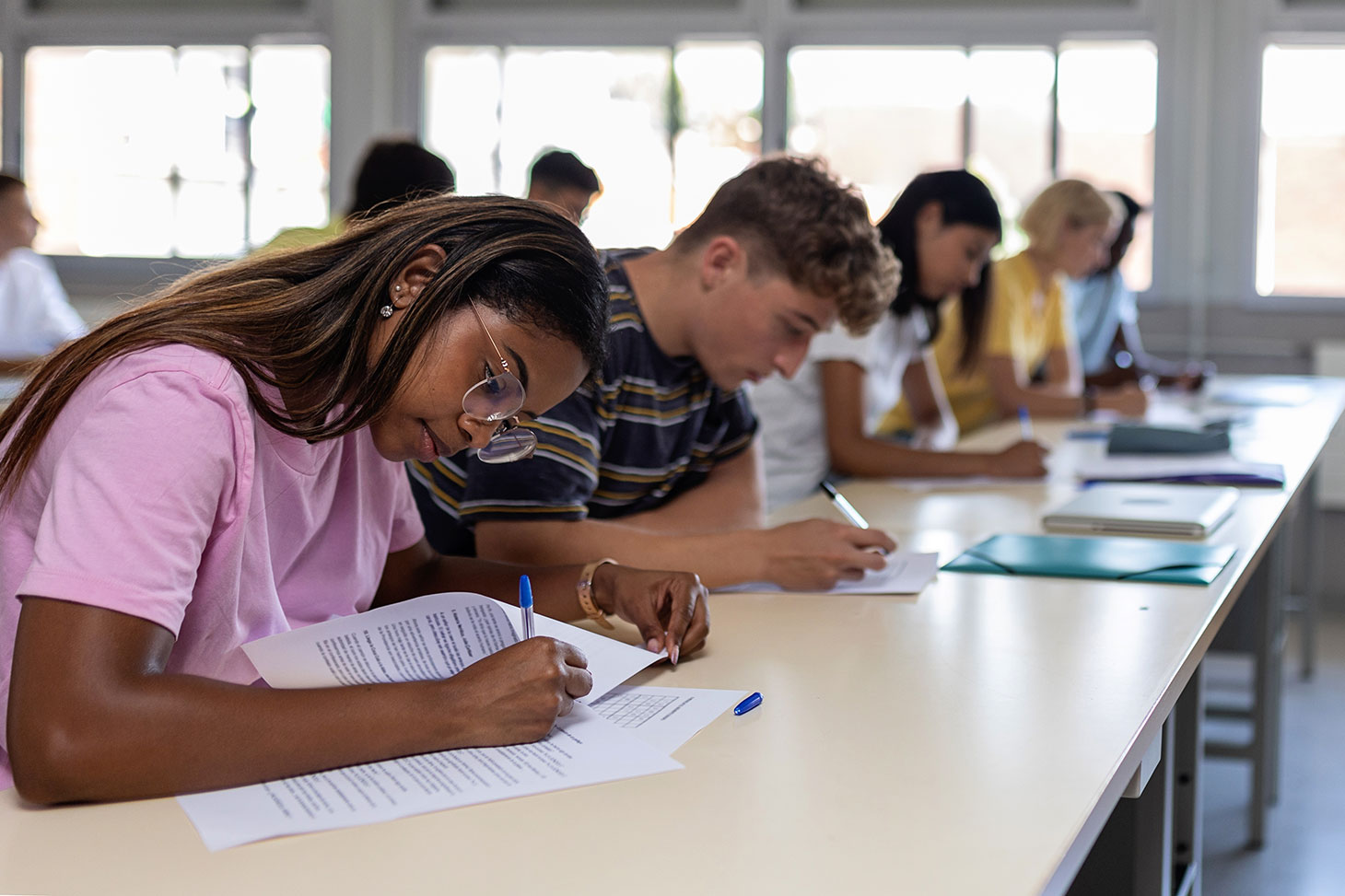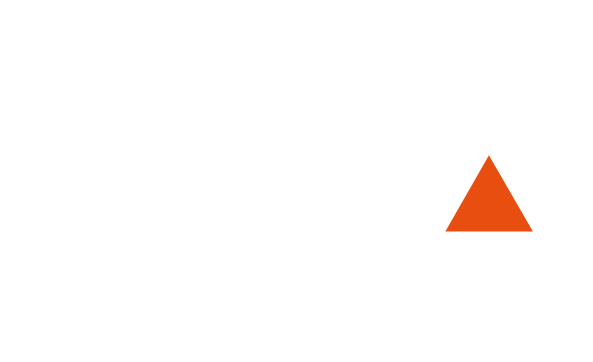Faut-il repenser les modalités du contrôle continu au lycée ? Toutes les notes de première et de terminale n’auraient plus vocation à compter pour le bac, a-t-il été annoncé lors de la conférence de presse de rentrée du ministère de l’éducation. La déclaration a suscité de nombreuses interrogations, et même provoqué de l’exaspération, chez les acteurs de terrain.
On peut comprendre ces réactions, car les changements en matière d’évaluation du bac n’ont pas manqué ces dernières années. Après l’adoption, en 2018, de la réforme « Blanquer », qui prévoit 40 % de contrôle continu, l’architecture de l’examen a connu d’incessantes évolutions.
Les années 2018, 2019 et 2020 ont été des années de tâtonnement. L’introduction d’épreuves spécifiques de contrôle continu (les E3C) provoque de fortes turbulences en 2019 et 2020. Du fait d’une grève de correcteurs, le contrôle continu simple (au fil de l’activité d’enseignement) fait, en 2019, une irruption surprise, avec recours aux notes du livret scolaire. En 2020, la pandémie de Covid contraint même à accepter 100 % de contrôle continu simple !
Les épreuves communes seront abandonnées en 2021. En 2022, on prend en compte les moyennes annuelles, et on supprime les épreuves finales pour les options. Depuis 2019, seules deux sessions se sont déroulées selon les mêmes modalités (2024, et 2025). Les acteurs ressentent un double besoin : de clarté, et de stabilité.
Pourquoi tant de fluctuations ? Dans un contexte où la notation devient une véritable obsession pour les élèves et leurs parents, et alors que le taux de réussite atteint 91,8 % en 2025, dont 96,4 % au bac général, une « réflexion d’ampleur » s’impose. Certes, s’agissant des détails, le « diable » s’en est mêlé. Il a fallu compter avec les pandémies, les jeux politiques, les mouvements sociaux. Mais sans doute l’essentiel se cache-t-il en profondeur.
Pour y voir clair, on peut recourir à un modèle de type « tectonique des plaques », en faisant l’hypothèse que se manifestent en surface les effets de frottements entre « plaques » souterraines, qui se confrontent du fait de dynamiques profondes qu’il s’agit d’identifier, au-delà des soubresauts et des crispations.
Une tension entre l’accompagnement et la certification
Sur le long terme, la scène évaluative est d’abord le lieu d’une coexistence conflictuelle entre deux exigences, s’inscrivant dans des desseins différents, bien que complémentaires. L’exigence d’accompagner et de faciliter un développement, dans un parcours de construction de connaissances et de compétences (exigence d’évaluation formative). Et l’exigence de certifier socialement la possession de ces connaissances et compétences (exigence d’évaluation certificative). Consolider les apprentissages vs attester socialement d’un niveau.
On pourrait dans le premier cas parler de fonction « GPS » (dire si l’on se tient bien sur la bonne route) ; et, dans le second, de la fonction « délivrance d’un permis » (attester socialement d’une capacité acquise à la fin d’un parcours de formation).
Le défi est ici d’articuler les deux fonctions de l’évaluation, en faisant en sorte que les nécessités de la certification ne viennent pas étouffer l’effort d’accompagnement. D’où l’idée, bienvenue de ce point de vue, d’introduire une part importante de contrôle continu. La première difficulté est alors de situer le bon niveau d’importance. La seconde, de trouver une forme pertinente de contrôle continu – contrôle continu simple, ou épreuves spécifiques ?
Une tension entre la localisation et la centralisation
Les deuxièmes « plaques » sont celles d’un mouvement de localisation, et d’un mouvement de centralisation. Leur confrontation prend le visage d’une lutte entre le désir de donner davantage de responsabilités aux acteurs locaux de l’évaluation, avec pour horizon le contrôle continu simple. Et celui d’imposer un cadre et un modèle centralisateurs, avec des épreuves nationales formalisées, et identiques dans tous les centres d’examen.
L’on pense souvent spontanément que la deuxième formule est préférable, car elle garantirait davantage l’objectivité de la notation. Pour ce qui concerne les évaluateurs, un conflit se déclare entre deux légitimités. Une légitimité locale : celle de l’enseignant professant une ou des disciplines au sein d’un établissement. Et une légitimité experte : celle d’un évaluateur extérieur, évaluant, selon des normes imposées, le travail effectué dans une épreuve officiellement définie, commune à tous, et respectant des garanties d’anonymat.
La confrontation entre ces deux « plaques » débouche sur la querelle du « biais local ». Si l’on admet la nécessité d’un contrôle continu, le problème est bien de savoir si, et comment, on peut échapper à la notation « à la tête du client ». Notons qu’à l’oral, quel que soit l’examinateur, le “client” sera toujours présent, avec sa « tête ». Et que les correcteurs du bac sont, par ailleurs, tous des enseignants, qui ne se libéreront pas, par magie, de ce qui peut biaiser leur agir de correcteur, et affecter leur manière de noter.
Cette deuxième tension place alors devant un deuxième défi : que le mouvement centralisateur vienne tempérer les effets contestables du localisme, sans toutefois imposer un formalisme rigide ; sans étouffer l’inventivité et le dynamisme du local.
Une tension entre une lutte pour des titres et une lutte pour des places
Les troisièmes « plaques » sont celles de l’examen, et du concours. Un conflit se produit entre deux enjeux. Un enjeu d’acquisition de titre scolaire/universitaire (logique d’examen : le bac est la porte d’entrée à l’enseignement supérieur). Et un enjeu d’occupation de place (logique de concours : le bac ouvre – ou n’ouvre pas – la porte pour accéder à des disciplines de formation en tension, où les places sont « chères », parce que quantitativement limitées et socialement désirées.
La comparaison entre élèves pour les places dans le supérieur devient le véritable enjeu pour les candidats. C’est alors, en effet, Parcoursup qui devient prépondérant. Et l’on pourrait, à cet égard, parler d’une « parcoursupisation » du bac. Mais cela fait passer d’une problématique d’examen (avoir ou non un diplôme), à une problématique de concours (dans les filières en tension, obtenir, ou non, les places convoitées). À l’examen, il faut réussir, pour obtenir un titre. Dans un concours, il faut réussir mieux que les autres, pour obtenir une place que d’autres convoitent aussi.
Faut-il alors distinguer les notes évaluatives (à usage interne, pour évaluer et scander la progression des élèves) et les notes certificatives (à usage externe, pour certifier les acquis et les prendre en compte dans Parcoursup) ? Et aller jusqu’à imaginer deux bulletins différents, l’un, purement informatif, contenant tous les résultats ; l’autre, ne contenant que les résultats jugés représentatifs, et comptant seul pour la validation du bac et le dossier Parcoursup ?
La problématique de concours donne à l’évaluation une fonction dominante de tri. Telle est la tâche centrale de Parcoursup : faire coïncider, autant que possible, la demande et l’offre. Faire tenir ensemble une pluralité donnée de demandes individuelles de formation, et un ensemble de places différenciées dans des filières de formation à capacité d’accueil limitée.
Le défi terminal est de créer les conditions d’un tri équitable. Il faudra pour cela que l’évaluation, qu’elle soit continue ou terminale, rende visible la réalité des compétences des candidats, et de leur niveau ! Toute la question est de savoir si, et comment, une évaluation peut apprécier (dire) objectivement une compétence, et se prononcer… sans trop se tromper !
Ainsi le bac, comme dispositif d’évaluation, doit-il faire face à trois défis, dont l’importance et la difficulté permettent de comprendre que, du fait de la persistance et du poids des « plaques » en frottement, les équilibres laborieusement mis en place seront toujours fragiles. Les formules d’examen retenues, toujours plus ou moins « bricolées » dans un contexte donné, seront toujours contestables. Ce qui promet encore bien des incompréhensions, des exaspérations, et des crispations…![]()