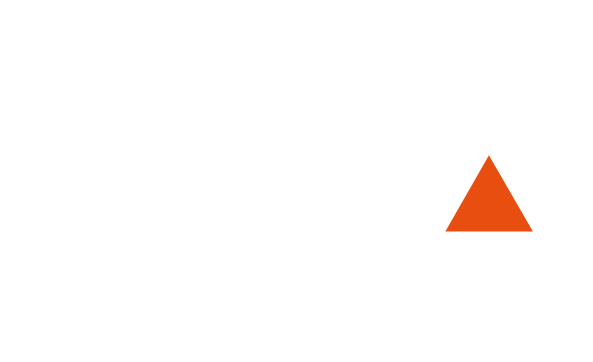À l’interface entre vallées et moyenne et haute altitude, les refuges jouent un rôle de plus en plus structurant dans la fréquentation de la montagne peu aménagée, à mesure que leur public s’élargit, et que leur statut et leurs fonctions initiales d’hébergement et de restauration se transforment et s’étoffent. Dans les Alpes françaises, on en recense 234 qui représentent une capacité d’accueil de 9 466 lits, dont 138 correspondent strictement aux trois critères de définition retenus par le Code du tourisme, à savoir : l’absence d’accès par voie carrossable ou remontée mécanique, l’inaccessibilité pendant au moins une partie de l’année aux véhicules de secours et la mise à disposition en permanence d’un espace ouvert au public.
Du fait de leurs caractéristiques géographiques, techniques, culturelles et fonctionnelles, ce sont des hébergements très atypiques au regard des standards touristiques conventionnels : accès pédestre à des sites isolés à haute valeur environnementale, souvent dotés d’un statut de protection ; déconnexion fréquente des réseaux de communication ; ressources très restreintes en eau et en énergie ; fortes contraintes de traitement ou de transport des rejets et déchets ; exiguïté de l’espace habitable ; éventualité de circonstances météorologiques exceptionnelles et de situations de risques (avalanches, écroulements rocheux) ou d’accidents ; exigence d’autonomie hors des périodes de gardiennage ou dans les cabanes non gardées.
Il en est de même en ce qui concerne les conditions de séjour : repas pris en commun, menu unique le soir, dortoirs collectifs… Ces particularités les inscrivent au cœur de questionnements sociétaux majeurs : relation à la nature, rapport au confort et à la frugalité, adaptation au changement climatique, sans oublier l’accessibilité sociale et le vivre-ensemble.
Une fréquentation relancée
Au cours de cinq dernières années, dans l’ensemble de l’Arc alpin, la fréquentation des refuges de montagne, mesurée en nuitées, a atteint des records. C’est le cas en Suisse, dès 2019, puis en France en 2023.
L’examen de l’évolution du nombre de nuitées annuelles sur une longue période montre cependant, pour la France, un tableau très contrasté. À l’échelle nationale, les nuitées enregistrées chaque année dans les refuges de la Fédération française des clubs alpins et de montagne (FFCAM) ont connu une nette baisse après un pic d’environ 300 000 nuitées atteint dans la première moitié des années 1990.
Après un rétablissement au début des années 2000, suivi d’une phase de stagnation, le nombre total de nuitées annuelles a recommencé à augmenter à partir de 2017, pour s’établir autour de 370 000 en 2023 et en 2024, selon les données de la FFCAM.
Pour l’année 2023, si l’on prend aussi en compte la fréquentation des 12 refuges du parc national de la Vanoise, c’est ce massif qui comptabilise la fréquentation annuelle la plus importante à l’échelle française (110 000 nuitées), suivi par le massif des Écrins (76 000 nuitées), puis par les Pyrénées (73 000 nuitées), le massif du Mont-Blanc (66 000 nuitées) et les Alpes du Sud (34 000 nuitées).
Contrastes de fréquentation entre moyenne et haute montagne
L’évolution de cette fréquentation est fortement différenciée selon les vallées et les secteurs, ainsi que selon l’altitude et l’accessibilité des sites. Les bâtiments de haute montagne situés au-dessus de 2 700 mètres, tournés majoritairement vers la pratique de l’alpinisme, connaissent à quelques exceptions une baisse tendancielle, alors que les refuges de moyenne montagne ou ceux qui sont les plus accessibles aux randonneurs connaissent une augmentation de fréquentation.
Un contraste très net s’accentue entre la pratique restreinte de l’alpinisme, qui concerne environ 200 000 personnes à l’échelle de la population française, et celle fortement répandue de la randonnée pédestre, qui concerne un public de 10,4 millions de pratiquants hors montagne et de 6,4 millions en montagne, d’après l’enquête nationale sur les pratiques physiques et sportives 2020.
De plus, la nouvelle donne climatique réduit drastiquement la pratique estivale de l’alpinisme, maintenant décalée d’un mois sur la fin du printemps, ce qui tend à instaurer une continuité avec la pratique du ski de randonnée, en fort développement depuis dix ans (jusqu’à représenter plus de 30 % des nuitées annuelles dans certains refuges).
Menaces, enjeux et dilemmes : bienvenue dans les refuges de l’anthropocène
Dans le même temps, l’impact du changement climatique sur les refuges s’amplifie, les bâtiments situés en haute montagne étant les plus vulnérables. Une étude récente portant sur un panel de 45 refuges situés dans trois massifs en Suisse (Valais) et en France (Écrins et Mont-Blanc) souligne que les trois quarts d’entre eux sont affectés par au moins deux des cinq types d’impacts identifiés : dégradation des accès routiers, dégradation des itinéraires pédestres, dommages aux bâtiments, raréfaction des ressources en eau et altération des conditions de pratique des activités autour des refuges.
Dans les années 2010, ce sont en premier lieu les accès aux refuges du bassin de la mer de Glace, dans le massif du Mont-Blanc, qui ont été bouleversés par le retrait glaciaire.
À partir de 2020, les refuges du massif des Écrins connaissent de multiples épisodes de fermeture définitive (la Pilatte, à 2 577 mètres ou temporaire, imputables à des déstabilisations géomorphologiques du fait du retrait glaciaire, à des crues torrentielles, des écroulements rocheux sur les sentiers d’accès ou des pénuries d’eau.
Au-delà des refuges, ce sont aussi toutes les infrastructures d’accès routières et pédestres qui les desservent qui sont régulièrement endommagées, avec comme sujet majeur la destruction chronique de passerelles et de sentiers. Dans les Écrins, les évènements météorologiques survenus en 2023 et en 2024 ont dégradé 30 kilomètres de sentiers sur le linéaire de 600 kilomètres géré par le parc national et détruit 53 des 120 des passerelles installées pour franchir les torrents. Le budget annuel consacré à l’entretien et à la restauration des sentiers et passerelles a augmenté de 65 % entre 2019 et 2024, passant de 260 000 euros à 435 000 euros (source : Parc national des Écrins) et constitue une charge financière de moins en moins soutenable.
Une complexification des conditions de fonctionnement et de gardiennage
La pression climatique s’accompagne de multiples facteurs de complexification qui accentuent la vulnérabilité des refuges en fragilisant les équilibres sur lesquels repose leur fonctionnement. Ainsi, la logique de montée en confort et de service qui a prévalu depuis le milieu des années 2010 se heurte aux impératifs de sobriété en matière d’énergie et de ressource en eau.
De même, l’inflation des coûts de rénovation et de soutenabilité environnementale d’un parc de bâtiments vieillissant fait face à l’érosion des financements publics.
Devant de telles mutations, les gardiens, qui ont le statut de travailleurs indépendants, voient leurs missions largement amplifiées, qu’il s’agisse d’accueillir des publics diversifiés, de transmettre des informations culturelles et patrimoniales, d’expliquer les changements paysagers et les enjeux de biodiversité, de gérer de fait le bivouac aux alentours du refuge, de délivrer des conseils en tout genre destinés à un public de primo-arrivants en montagne, voire de réguler certains comportements maladroits ou inappropriés.
Les refuges, des laboratoires de transition
Malgré le regain d’intérêt qu’ils suscitent et leur rôle d’outil d’aménagement et de vecteur d’accès à la montagne, les refuges sont soumis à de fortes incertitudes structurelles et fonctionnelles dont le tableau peut sembler très sombre. De fait, c’est bien le maintien de l’intégrité du parc actuel qui est remis en question par les effets croisés des destructions climatiques et de l’effondrement programmé des financements publics.
Les logiques de fluidité de fréquentation, fondées sur une mobilité automobile généralisée, instituées depuis des décennies, sont à réinterroger, aussi bien en ce qui concerne l’accès aux hautes vallées, la localisation des parkings, le réseau de chemins d’accès et de passerelles, et le niveau d’entretien des itinéraires de randonnée et d’ascension.
Il s’agit de redéfinir les pratiques touristiques et sportives, en imaginant des séjours plus longs, des itinérances, des périodes de gardiennage élargies. Avec notamment pour enjeu un ré-étagement des refuges en altitude et un redimensionnement (à la hausse ou à la baisse, selon les situations locales) des capacités d’hébergement. L’ensemble des paramètres qui conditionnent le statut et le fonctionnement des refuges doit désormais être pris en compte, comme la question de leur accessibilité sociale, de leur soutenabilité environnementale, de leur mode de gardiennage et de leur modèle économique.
Cette réflexion prospective a fait l’objet d’ateliers créatifs et collaboratifs RefugeRemix organisés en 2019, en 2023 et en 2024 dans le cadre des programmes de recherche Refuges sentinelles et HutObsTour. Dans la continuité des Rencontres sur les refuges au cœur des transitions, organisées en 2023, cette réflexion mobilise les parties prenantes du secteur autour d’une plateforme dont l’objectif est d’élaborer une feuille de route pour l’avenir, sous l’égide du Commissariat de massif des Alpes et avec l’appui du parc national des Écrins.
L’équipe des programmes Refuges sentinelles et HutObsTour a participé à la rédaction de cet article : Victor Andrade, Richard Bonet, Laine Chanteloup, Mélanie Clivaz, Marc Langenbach, Jean Miczka, Justin Reymond, Sophie de Rosemont. Merci également à Brice Lefèvre et Pierrick Navizet.![]()