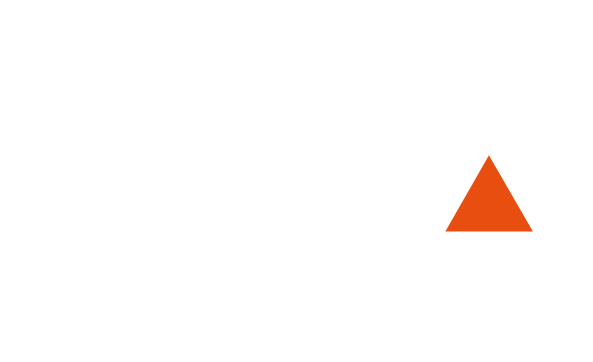« Quand la science résiste », tel était le thème fort proposé cette année par le Climat Libé Tour pour sa deuxième édition à la MC2 de Grenoble, les 24 et 25 septembre dernier. Une nouvelle édition où l’Institut des géosciences de l’environnement (IGE - CNRS/INRAE/IRD/UGA - Grenoble INP-UGA) a joué un rôle majeur avec de nombreuses interventions de ses chercheurs et chercheuses lors des débats à la MC2, et surtout l’accueil de public au sein même du laboratoire pour une immersion scientifique unique.
Près de
20 personnes du Climat Libé Tour ont fait étape mercredi 24 septembre à l’IGE sur le campus universitaire de Saint-Martin-d’Hères. Le créneau du mercredi après-midi a permis de toucher des personnes de tous âges qui pour la plupart franchissaient les portes d’un laboratoire pour la première fois.
Une visite en 4 temps avec d’abord un mot du directeur et une
présentation rapide du laboratoire, ses missions, son fonctionnement et ses thématiques de recherche, suivis de
3 ateliers de 30 minutes en petits groupes : un atelier
instruments de mesure du climat[1], un atelier
glaciologie[2] et un atelier
océanographie[3].
 « La mission des laboratoires, c'est aussi d’informer les scolaires, le grand public et nos politiques quand on peut les atteindre. C’est une des raisons pour laquelle l’IGE participe à un certain nombre d'événements dont le Climat Libé Tour est un exemple. Les liens avec la métropole sont très forts pour nous permettre aussi d'atteindre le grand public et d'ouvrir les portes des laboratoires. Vous allez voir qu'il y a plein de choses qui se font et même avec des connaissances scientifiques minimales on peut arriver à comprendre beaucoup de choses. »
« La mission des laboratoires, c'est aussi d’informer les scolaires, le grand public et nos politiques quand on peut les atteindre. C’est une des raisons pour laquelle l’IGE participe à un certain nombre d'événements dont le Climat Libé Tour est un exemple. Les liens avec la métropole sont très forts pour nous permettre aussi d'atteindre le grand public et d'ouvrir les portes des laboratoires. Vous allez voir qu'il y a plein de choses qui se font et même avec des connaissances scientifiques minimales on peut arriver à comprendre beaucoup de choses. » Aurélien Dommergue, Pr. UGA et directeur de l’Institut des géosciences de l’environnement.
Atelier 1 - Des instruments high-techs sur le toit du laboratoire pour traquer chaque goutte de pluie

Sur le toit de la Maison climat Planète de l’IGE, des outils sophistiqués scrutent le ciel. Parmi eux, des pluviomètres à augets basculants : automatisés, ils mesurent les précipitations sans intervention humaine, mais restent sensibles aux erreurs (évaporation, poussières, pollen). Pour affiner les données, un disdromètre analyse goutte à goutte, taille, vitesse et type de précipitation (pluie, grêle, neige), malgré les perturbations du vent ou… des toiles d’araignée !
Plus innovant encore, un radar qui émet des ondes à fréquence modulée verticalement à l'infini. Ces ondes quand elles détectent des cibles (des gouttes d’eau), elles vont réfléchir l'énergie de puissance qui va être capter et nous permettre d’en déduire l'intensité des précipitations. Un autre radar observe quant à lui horizontalement et voit jusqu'à 60km. C'est une antenne rotative qui tourne donc dans toutes les directions et envoie des impulsions puis se met en mode écoute de l’écho renvoyé par les cibles dans l’environnement. Le radar perché sur le Moucherotte, qui dépend lui de Météo-France, fonctionne de la même manière sur un autre périmètre et permet de venir compléter les données.
Ces technologies, couplées à des capteurs de foudre, température, rayonnement solaire et pression, alimentent des modèles météo. Pourtant, mesurer la quantité d’eau dans un nuage reste un défi : « Il faut y aller », souligne la jeune chercheuse qui anime l’atelier, évoquant les avions instrumentés.
Tous ces instruments sont là plus ou moins temporairement pour faire des tests mais des installations similaires sont installées par les chercheurs et chercheuses, sur le terrain pour instrumenter un terrain spécifique comme un glacier.
Atelier 2 - Les glaciers : géants de glace en sursis, témoins du réchauffement climatique

Un glacier c’est une accumulation de neige pendant l’hiver (ou la saison humide à d’autres latitudes), qui se transforme en névé puis en glace. Sous l’effet de son poids cette glace va s’écouler vers l’aval comme un fluide très visqueux. En arrivant à plus basse altitude où les températures sont plus élevées, cette glace fond : c’est ce qu’on appelle la zone d’ablation. Entre la zone d’accumulation (en haute altitude) et la zone d’ablation (où la glace fond), s’établit un équilibre fragile. Aujourd’hui, avec le réchauffement, la ligne d’équilibre entre ces zones augmente, accélérant le recul des glaciers. Dans les Alpes par exemple, la Mer de Glace perd plus de 5 mètres d’épaisseur par an (10 m de fonte, partiellement compensés par l’écoulement).
L’ensemble des glaciers du monde représentent 700 000 km² (soit un peu plus que la France métropolitaine) et réagissent vite aux variations climatiques. Selon le GIEC, leur recul est un marqueur clé du dérèglement. Si l’ensemble des glaciers venait à fondre on observerait à peu près un demi-mètre d’élévation du niveau des mers. Mais plus directement dans les Alpes, leur fonte qui s’accélère a de grosses conséquences sur l’hydrologie et les écosystèmes locaux. Malheureusement, chaque tonne de CO₂ émise aujourd’hui équivaut à 20 tonnes de glace en moins d’ici 2100. Un aller-retour Paris-New York en avion ? 40 tonnes de glace perdues…
Afin d’étudier les glaciers et leur évolution, les glaciologues grenoblois combinent mesures de terrain (balises, carottages, stations météo) et télédétection (satellites, drones). À Grenoble, GLACIOCLIM (« GLACiers, un Observatoire du CLIMat ») est un programme du CNRS Terre & Univers. Labellisé Service National d’Observation, il suit depuis longtemps plusieurs glaciers de référence afin de mesurer de façon homogène et durable les effets du changement climatique. Ainsi GLACIOCLIM suit 5 glaciers alpins, deux glaciers dans les Andes tropicales, deux sites en Antarctique et le glacier du Mera au Népal. Parmi les mesures, les scientifiques calculent le bilan de masse (gain ou perte de glace sur un an), un indicateur clé de la santé du glacier.
Depuis les années 1960, des satellites militaires américains et soviétiques ont photographié la Terre avec une précision inégalée. La caméra embarquée dans les satellites de l'époque était assez complexe. Elle prenait des films photographiques, argentiques (pas d'images numériques comme aujourd'hui), puis il y avait toute une manœuvre pour éjecter ces films qui étaient renvoyés dans l'atmosphère terrestre dans une petite capsule et qui étaient récupérés au sol et analysés. Ces précieuses images, déclassifiées dans les années 1990, offrent aujourd’hui une mine d’informations avec une résolution exceptionnelle, jusqu’à 2 000 mégapixels (contre 20 pour un smartphone) et une couverture globale, des millions de clichés, permettant de comparer l’état des glaciers sur plusieurs décennies. Le glaciologue de l’IGE qui anime l’atelier est l’une des rares personnes dans le monde à manipuler ces données qui révèlent l’ampleur du recul glaciaire.
Atelier 3 - Océanographie : la circulation thermohaline décryptée grâce à une maquette

Les océans, qui couvrent 70 % de la Terre, cachent des mécanismes clés pour le climat et il est donc très important de les étudier pour bien les comprendre. Leur profondeur moyenne ? 6 000 mètres, avec des fosses comme celle des Mariannes (10 000 m) entre le Japon et les Philippines. Leur salinité, 35 g de sel par litre, varie selon les régions et influence directement les courants, c’est pourquoi les océanographes s’intéressent grandement à cette donnée dans la compréhension de l’océan.
Grâce à une maquette ingénieuse, deux jeunes scientifiques ont montré comment la température et la salinité mettent les océans en mouvement. Une cuve remplie d’eau représente l’océan. En chauffant un côté de la cuve avec une sonde (comme au niveau de l’équateur dans l’océan), l’eau à température ambiante colorée en rouge (pour suivre son déplacement) injectée au niveau de la sonde devient alors plus chaude, donc plus légère et remonte à la surface, puis s’étale vers le pôle. À l’inverse, de l’autre côté de la cuve, l’ajout de glaçons imite les eaux froides de l’Arctique : l’eau colorée en bleu, plus dense, plonge en profondeur. La salinité agit de la même manière : plus l’eau est salée, plus elle coule. L’eau froide et salée circule alors en profondeur et revient vers l’équateur, bouclant ainsi un cycle permanent. Ce processus, appelé circulation thermohaline, transporte chaleur et nutriments à travers la planète et contribue à réguler le climat.
Avec le réchauffement, ce système fragile est perturbé. Les chercheurs s’appuient sur des données satellites, des flotteurs autonomes, des campagnes en mer, etc. pour comprendre ces changements. Grâce à l’analyse et aux modèles, deux constats sont déjà certains : 1. L'océan devient de plus en plus acide avec l’augmentation de la concentration de CO2. 2. L'océan capte plus de chaleur que l'atmosphère car un liquide peut accumuler beaucoup plus d'énergie. Mais le risque majeur serait un arrêt des courants, comme le Gulf Stream, qui pourrait bouleverser complètement les équilibres climatiques. Sur ce point les avis divergent encore. Va-t-on atteindre ce point de bascule, c’est-à-dire le moment où il n’y aura plus de retour en arrière possible ?
Grâce à son expertise en mécanique des fluides et aux données satellites, l’écosystème scientifique grenoblois contribue à percer les secrets des abysses, même sans accès direct à la mer.
Les débats science et politique : à Grenoble, l’alliance gagnante pour le climat
L’Institut des géosciences de l’environnement était également présent à la MC2, le jeudi notamment à travers une table ronde qui a particulièrement mis en avant les liens entre territoires, collectivités et scientifiques. Deux scientifiques de l’IGE y ont participé :
- Juliette Blanchet, une hydrostatisticienne, membre du Groupe Régional d’Expertise sur le Climat (GREC) Alpes-Auvergne,
- Thierry Lebel, un climatologue, co-président du Conseil scientifique Climat et Transition de Grenoble Alpes Métropole.
Leur double rôle, à la fois chercheurs et experts engagés dans ces instances, illustre l’investissement des scientifiques de l’IGE auprès des territoires, de la société civile et des décideurs, pour accompagner la transition face au changement climatique.
Face à des défis complexes (climat, eau, énergie), les élus de Grenoble-Alpes Métropole s’appuient sur des conseils scientifiques pluridisciplinaires.
« Sans données robustes, on décide dans le brouillard », résume Christophe Ferrari, président de la Métro et ancien chercheur. L’enjeu : détricoter la complexité pour agir efficacement, en intégrant les incertitudes.
Juliette Blanchet, chercheuse à l’IGE, co-anime le GREC Alpes-Auvergne, qui adapte les rapports du GIEC aux réalités locales. Exemple : une étude sur les inondations simultanées dans les torrents alpins, née d’un dialogue entre scientifiques et agents métropolitains.
« Les territoires posent des questions que la recherche n’avait pas anticipées », souligne-t-elle.
Impliqué dans les COP internationales (dont la COP21), Thierry Lebel, climatologue, souligne que
« la notion de scientifique ne doit pas être limitée au monde académique et qu’il existe une responsabilité sociale à expliquer méthodes, incertitudes et résultats ». À Grenoble, cela se traduit par des projets de recherche ciblés, des données ouvertes et un débat citoyen nourri.

« Que reste-t-il à découvrir » carte blanche à Fanny Brun, glaciologue à l’IGE
Dans cette carte blanche d’une heure, Fanny Brun, aborde la manière dont on mesure les glaciers, en mettant l'accent sur les méthodes utilisées pour évaluer leurs changements au fil du temps. Elle s’est concentrée ensuite sur les perspectives d'avenir des glaciers en lien avec les changements climatiques et leurs impacts. Puis elle a plongé le public dans le quotidien du métier de chercheur, avec une anecdote sur une dispute scientifique, illustrant comment la connaissance est produite dans ce contexte. Enfin elle a tenté de répondre à la question « que reste-t-il à découvrir ? » en évoquant notamment l’impact des glaciers sur les systèmes hydrologiques et comment modéliser l'évolution des ressources en eau.