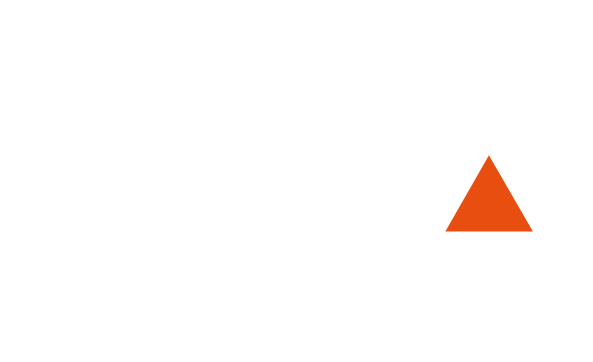La semaine dernière, quatre lasers ont été projetés dans le ciel depuis le site du Paranal de l’Observatoire Européen Austral (ESO) au Chili. Chacun de ces lasers sert à créer une étoile artificielle, utilisée par les astronomes pour mesurer puis corriger la turbulence atmosphérique qui brouille les images. Le lancement spectaculaire de ces lasers - un sur chacun des télescopes de huit mètres du Paranal - constitue une étape majeure du projet international GRAVITY+ auquel participe l’Université Grenoble Alpes à travers son laboratoire IPAG (UGA/CNRS), une mise à niveau vaste et complexe de l’interféromètre du Très Grand Télescope (VLTI) de l’ESO.
GRAVITY+ ouvre à cet instrument une puissance d’observation accrue et une couverture du ciel bien plus étendue qu’auparavant.
"C’est une étape très importante pour une installation absolument unique au monde", déclare
Antoine Mérand, astronome de l’ESO et scientifique du programme VLTI.
Le
VLTI combine la lumière provenant de plusieurs télescopes individuels du
VLT (les quatre télescopes unitaires de huit mètres - UT - ou les quatre télescopes auxiliaires plus petits) grâce à la technique de l’
interférométrie.
GRAVITY+ est une mise à niveau du VLTI, centrée sur
GRAVITY, un instrument extrêmement performant ayant déjà permis
d’imager des exoplanètes,
d’observer des étoiles proches et lointaines et d’étudier en détail des
objets faibles en orbite autour du trou noir supermassif au centre de la Voie lactée.
Le projet comprend également des modifications structurelles sur les télescopes et dans les tunnels souterrains du VLTI, où les faisceaux lumineux sont combinés.
L’installation d’un laser sur chacun des télescopes unitaires précédemment non équipés constitue une avancée clé de ce projet de longue haleine, transformant le VLTI en l’interféromètre optique le plus puissant au monde.
« Le VLTI avec GRAVITY a déjà permis tant de découvertes inattendues ; nous sommes impatients de voir jusqu’où GRAVITY+ repoussera encore les limites », explique
Frank Eisenhauer, chercheur principal du projet GRAVITY+ à
l’Institut Max-Planck de Physique Extraterrestre (MPE) en Allemagne, qui dirige le consortium responsable de la mise à niveau
1.
Les différentes améliorations du système, en cours depuis plusieurs années, incluent une technologie d’optique adaptative revisitée - un dispositif corrigeant la turbulence atmosphérique - intégrant des capteurs et des miroirs déformables de pointe.
Jusqu’à présent, le VLTI devait corriger les effets de l’atmosphère à l’aide d’étoiles de référence brillantes situées à proximité de la cible, limitant ainsi le nombre d’objets observables.
Grâce aux lasers installés sur chacun des UT, une étoile artificielle brillante est désormais créée à
90 km au-dessus de la Terre, permettant de corriger les effets atmosphériques sur n’importe quelle région du ciel.
Le VLTI peut ainsi accéder à l’ensemble du ciel austral et voit sa puissance d’observation décuplée.
« Cela ouvre l’instrument à l’étude d’objets de l’Univers primitif et lointain, comme le quasar observé lors de la deuxième nuit, où nous avons pu résoudre le gaz chaud émettant de l’oxygène à proximité immédiate du trou noir », explique
Taro Shimizu, astronome au MPE et membre du consortium de l’instrument.
Avec ces lasers, les astronomes pourront étudier des
galaxies actives lointaines, mesurer directement la masse
des trous noirs supermassifs qui les alimentent, ainsi qu’observer des
étoiles jeunes et les
disques protoplanétaires qui les entourent.
Les capacités améliorées du VLTI permettront d’augmenter considérablement la quantité de lumière collectée, rendant l’installation jusqu’à dix fois plus sensible.
« Un objectif majeur de GRAVITY+ est de permettre des observations profondes d’objets très faibles », précise
Julien Woillez, astronome de l’ESO et scientifique du projet GRAVITY+.
Cette sensibilité accrue rendra possible l’observation de
trous noirs stellaires isolés, de
planètes errantes ne tournant autour d’aucune étoile, ainsi que des
étoiles les plus proches du trou noir supermassif Sgr A* au centre de la Voie lactée.
La première cible des équipes GRAVITY+ et ESO à Paranal, lors des essais utilisant les nouveaux lasers, fut un
amas d’étoiles massives au centre de la nébuleuse de la Tarentule, une région de formation stellaire située dans notre galaxie voisine,
le Grand Nuage de Magellan.
Ces premières observations ont révélé qu’un objet lumineux de la nébuleuse, jusqu’ici considéré comme une étoile unique extrêmement massive, est en réalité un système binaire de deux étoiles proches.
Cette découverte illustre à merveille les capacités scientifiques exceptionnelles du VLTI modernisé.
Cette avancée dépasse le simple cadre d’une mise à jour : elle avait été envisagée il y a plusieurs décennies. Le système laser avait été proposé dès 1986, dans le rapport final du projet "
Very Large Telescope", avant même la création du VLTI : « Si cela pouvait fonctionner en pratique, ce serait une percée », affirmait le rapport.
Cette percée est désormais une réalité.
1. Le consortium GRAVITY+ regroupe les partenaires suivants :
- Max-Planck-Institut für Extraterrestrische Physik (MPE) ; Max-Planck-Institut für Astronomie ; Université de Cologne (Allemagne)
- Institut National des Sciences de l’Univers, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) ; Institut de Planétologie et d’Astrophysique de Grenoble (CNRS/UGA) ; Laboratoire d’Instrumentation et de Recherche en Astrophysique (LIRA) ; Laboratoire Lagrange ; Centre de Recherche Astrophysique de Lyon (France)
- Centre for Astrophysics and Gravitation (CENTRA), Instituto Superior Técnico ; Université de Lisbonne ; Université de Porto (Portugal)
- Université de Southampton (Royaume-Uni)
- Katholieke Universiteit Leuven (Belgique)
- University College Dublin (Irlande)
- Instituto de Astronomía – Universidad Nacional Autónoma de México (Mexique)
- Observatoire Européen Austral (ESO)
Informations complémentaires
Les co-chercheurs de GRAVITY+ sont :
Frank Eisenhauer (PI, MPE, Allemagne) ; Paulo Garcia (Faculdade de Engenharia, Universidade do Porto et CENTRA, Portugal) ; Sebastian Hönig (Université de Southampton, Royaume-Uni) ; Laura Kreidberg (Max-Planck-Institut für Astronomie, Allemagne) ; Jean-Baptiste Le Bouquin (IPAG, Université Grenoble Alpes, France) ; Thibaut Paumard (LIRA, Observatoire de Paris, France) ; Christian Straubmeier (Université de Cologne, Allemagne).
À l’ESO, la mise à niveau GRAVITY+ est dirigée par
Frédéric Gonté (chef de projet),
Julien Woillez (scientifique du projet),
Sylvain Oberti (ingénieur du projet) et
Luis Esteras Otal (ingénieur systèmes VLTI).
L’observatoire du Paranal de l’ESO au Chili est actuellement menacé par le projet INNA, prévu à seulement 11 kilomètres du VLTI.
Une source d’inquiétude majeure vient des microvibrations que ce projet pourrait engendrer, rendant la combinaison de la lumière dans les tunnels du VLTI beaucoup plus difficile.
Une analyse technique détaillée menée plus tôt cette année a montré que les turbines éoliennes du projet pourraient augmenter les vibrations du sol au point de compromettre les opérations du VLTI.
Le relocalisation de projets industriels tels qu’INNA hors de la zone entourant Paranal est essentielle pour préserver la performance de ces installations astronomiques de classe mondiale, ainsi qu’un site exceptionnel offrant un ciel pur et des conditions d’observation uniques.
À propos de l’ESO
L’
Observatoire Européen Austral (ESO) permet aux scientifiques du monde entier de percer les secrets de l’Univers, au bénéfice de tous.
Ses équipes conçoivent, construisent et exploitent des observatoires au sol de classe mondiale - utilisés par les astronomes pour répondre à des questions fascinantes et partager la passion de l’astronomie - et favorisent la coopération internationale dans ce domaine.
Créé en 1962 en tant qu’organisation intergouvernementale, l’ESO compte aujourd’hui
16 États membres (Autriche, Belgique, Tchéquie, Danemark, France, Finlande, Allemagne, Irlande, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Espagne, Suède, Suisse et Royaume-Uni), ainsi que le Chili en tant qu’État hôte et l’Australie comme partenaire stratégique.
Son siège, ainsi que le centre de visite et planétarium ESO Supernova, se trouvent près de Munich, en Allemagne.
Dans le désert d’Atacama au Chili, l’ESO exploite
trois sites d’observation : La Silla, Paranal et Chajnantor.
À Paranal, l’ESO opère le Très Grand Télescope (VLT) et son interféromètre (VLTI), ainsi que des télescopes de relevés tels que VISTA.
Le site accueillera également le
réseau sud de l’Observatoire CTA (Cherenkov Telescope Array), le plus grand et le plus sensible observatoire de rayons gamma au monde.
En collaboration avec des partenaires internationaux, l’ESO exploite
ALMA à Chajnantor, observatoire spécialisé dans les longueurs d’onde millimétriques et submillimétriques.
Enfin, à Cerro Armazones, près de Paranal, l’ESO construit le plus grand œil du monde tourné vers le ciel -
le Télescope Extrêmement Grand (ELT).
Depuis leurs bureaux de Santiago du Chili, les équipes soutiennent leurs opérations nationales et collaborent étroitement avec les partenaires et la société chilienne.