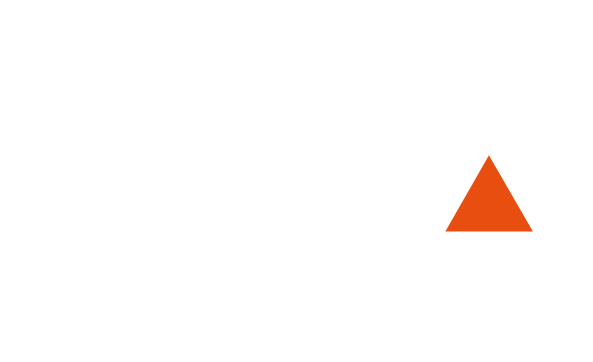En Angleterre, au XIXe siècle, le milieu médical fut secoué par un scandale lié à des excisions du clitoris pratiquées par un chirurgien de renom. L’absence de consentement éclairé des patientes fut au cœur des débats, une question qui reste d’actualité concernant la santé des femmes, et au-delà.
En 2008, l’Assemblée mondiale de la santé de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) adoptait la résolution WHA61.16 sur l’élimination des mutilations génitales féminines (MGF), dans laquelle elle appelait à l’intervention concertée des gouvernements, des organismes internationaux et des organisations non gouvernementales.
Quand parle-t-on de mutilations génitales féminines ?
- Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les mutilations génitales féminines (MGF) comprennent toutes les interventions qui impliquent l’ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme ou toute autre lésion des organes génitaux féminins, qui sont pratiquées pour des raisons non médicales.
État des lieux des mutilations génitales féminines dans le monde
L’OMS estimait à l’époque que 100 à 140 millions de femmes dans le monde avaient été victimes de telles mutilations, le plus souvent pratiquées entre la petite enfance et l’âge de 15 ans. En 2025, elles sont plus de 230 millions à avoir subi des mutilations génitales féminines dans 30 pays d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie et 3 autres millions sont exposées à en subir chaque année. Cette augmentation ne serait pas attribuable à une plus grande fréquence de mutilations génitales féminines mais à l’augmentation de la population dans les pays concernés.
Quatre grandes catégories de mutilations génitales féminines, selon l’OMS :
- Type 1 : ablation partielle ou totale du gland clitoridien (petite partie externe et visible du clitoris et partie sensible des organes génitaux féminins) et/ou du prépuce/capuchon clitoridien (repli de peau qui entoure le clitoris).
- Type 2 : ablation partielle ou totale du gland clitoridien et des petites lèvres (replis internes de la vulve), avec ou sans excision des grandes lèvres (replis cutanés externes de la vulve).
- Type 3 : « infibulation », ou rétrécissement de l’orifice vaginal par recouvrement, en sectionnant et en repositionnant les petites lèvres, ou les grandes lèvres, parfois par suture, avec ou sans ablation du prépuce/capuchon et gland clitoridiens.
- Type 4 : toutes les autres interventions néfastes au niveau des organes génitaux féminins à des fins non médicales, consistant par exemple à piquer, à percer, à inciser, à racler ou à cautériser les organes génitaux.
Des cas d’excisions du clitoris au XIXᵉ siècle en Angleterre
La pratique de la « clitoridectomie », à savoir l’excision du clitoris – et parfois des lèvres –, généralement associée aujourd’hui à certaines régions du monde et communautés religieuses et culturelles a, pendant un temps, au cours du XIXᵉ siècle, également été prônée en Europe comme « remède » à la masturbation, à la nymphomanie, à l’hystérie et autres « troubles nerveux » supposés.
Elle est, en Angleterre, associée au nom d’Isaac Baker Brown, chirurgien et obstétricien de renom qui, en publiant un compendium de ses opérations, suscita, en 1866, un scandale majeur au sein de la toute jeune profession de gynécologues et obstétriciens.
Ce scandale, qui illustre l’une des tristes rencontres entre chirurgie et aliénisme ainsi que la peur suscitée par la sexualité féminine à l’époque victorienne, nous donne de façon plus inattendue, l’occasion d’identifier l’une des toutes premières mentions, au sein de la profession médicale britannique, de la notion de « consentement éclairé » (selon la définition de l’article 6 de la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme.
Un scandale associé au nom d’Isaac Baker Brown

La clitoridectomie, il est important de le souligner au détriment du sensationnalisme, a été, en Grande-Bretagne, essentiellement l’histoire d’un seul homme, Isaac Baker Brown. Alors au sommet de sa carrière, le médecin postule que le remède aux maladies nerveuses de ses patientes consisterait tout simplement à retirer la cause de l’excitation, à savoir le clitoris.
Il se base sur les liens alors établis par certains médecins entre lésions du système nerveux central et excitation des nerfs périphériques (dont le « nerf pudendal ») et, pour ce faire, se réfère notamment aux conférences de Charles Brown Séquart, « Lectures on the Physiology and Pathology of the Central Nervous System », dispensées au Royal College of Surgeons of England.
Entre 1858 et 1866, Isaac Baker Brown pratique 47 clitoridectomies sur des femmes âgées de 21 à 55 ans, qu’il relate en détail dans On the Curability of Certain Forms of Insanity, Epilepsy, and Hysteria in Females. Toutefois, au lieu de renforcer sa notoriété, la publication de cet ouvrage enflamme les esprits et les plumes.
La revue médicale le Lancet ouvre les hostilités en juin 1866 : un confrère, Harry Gage Moore, y dénonce l’opération subie par l’une de ses patientes de 26 ans, sans aucun bénéfice et au prix d’intenses douleurs.
Rapidement, d’autres témoignages affluent :
« Certaines patientes auraient été opérées à leur insu ; d’autres, persuadées que l’intervention était bénigne. »
L’affaire prend une telle ampleur que Baker Brown accepte la création d’une commission d’enquête et promet de suspendre ses pratiques. Accusé, quelques mois plus tard, d’avoir manqué à sa parole, il se voit contraint de se présenter, en avril 1867, devant le Conseil de la toute jeune Société d’obstétrique de Londres (London Obstetrical Society), qui décidera, à 194 voix contre 38, son expulsion.
Éthique et « consentement éclairé »
Si l’on situe généralement l’apparition de l’expression « consentement éclairé » aux années 1950 (la décision Schloendorff v. Society of New York Hospital de 1914 ne concernait quant à elle que le « consentement simple »), c’est pourtant bien de cela dont il est question dans les débats autour de la clitoridectomie auxquels on assiste entre juin 1866 et avril 1867.
La lecture des courriers et procès-verbaux des différentes réunions révèle en effet une évolution très rapide du débat de la question de l’efficacité de l’opération, dénoncée par de nombreux confrères comme « une mutilation abominable et inutile » (Henry MacCormac M.D., “Askesis”, Medical Times and Gazette, 23 mars 1867, p. 317), à celle du lien de confiance entre médecin et patiente ou patient.
Si les patientes de Baker Brown, célibataires et mariées, se sont souvent présentées de leur propre chef à la London Surgical Home où Brown opère, il s’avère en effet que le médecin a parfois pratiqué l’excision lors d’interventions annexes, sans consentement préalable, et que même lorsque celui-ci avait été obtenu, de nombreuses femmes ignoraient la véritable portée de l’acte chirurgical.
Charles West relate ainsi le cas d’une de ses patientes, amputée de son clitoris par I. Baker Brown lors d’une opération pour une fissure anale (British Medical Journal, 15 décembre 1866 : 679).
Dès décembre 1866, The Lancet soutient l’affirmation de Charles West pour qui
« l’ablation du clitoris pratiquée à l’insu de la patiente et de ses proches sans explication complète de la nature de l’intervention… est extrêmement inappropriée et mérite la plus ferme réprobation »
(« The operation of excision of the clitoris », The Lancet, 22 décembre 1866 : 698).
Quelques mois plus tard, la revue va plus loin : même si l’opération pouvait s’avérer utile, est-il « éthiquement correct, interroge-t-elle, de mutiler une femme atteinte de troubles mentaux qui ne peut légalement consentir à une telle opération, même si cette dernière pouvait s’avérer utile » (« The Surgical Home », The Lancet, 2 février 1867 : 156).
La question éthique, liée à celle du consentement éclairé, apparaît par la suite au premier rang des accusations portées à l’encontre de Baker Brown lors du débat qui mène à l’exclusion de ce dernier de la profession, en avril 1867. Un éditorial paru quelques jours plus tard dans le Medical Times and Gazette et intitulé « Clitoridectomy and Medical Ethics » mérite également d’être mentionné dans la mesure où s’y trouve dénoncé le processus de diagnostic lui-même.
De jeunes femmes, expliquait l’article, pouvaient être profondément ignorantes de la nature et de la portée des questions posées lors de la consultation (« Ressentez-vous une irritation dans certains organes ? », « Est-ce très grave ? », « Cela vous pousse-t-il à les frotter ? ») ; elles pouvaient aussi être enclines à exagérer leurs sensations afin d’aller dans le sens du médecin et répondre positivement à toute question suggestive. Le consentement ne devait donc pas, éthiquement, être un « consentement routinier ».
L’éthique médicale exigeait à la fois le consentement et l’information préalable de la patiente (ses proches ne sont pas mentionnés cette fois-ci) quant à la nature et aux conséquences d’une opération. Celle-ci impliquait non seulement l’information, mais une véritable compréhension de la « portée réelle », de la « nature » et des conséquences « morales » de l’opération.
De tels prérequis correspondent indubitablement à ce que l’on définit aujourd’hui comme le « consentement éclairé » et semblent indiquer que celui-ci, contrairement à ce qui a pu être affirmé jusqu’à une date récente, fut conceptualisé en Grande-Bretagne avant le XXe siècle, anticipant de façon étonnante les principes modernes de bioéthique.
De l’Angleterre victorienne aux enjeux contemporains
L’affaire Baker Brown marque un tournant. Après 1867, la clitoridectomie dite « thérapeutique » disparaît du paysage médical britannique (elle perdurera toutefois bien au-delà aux États-Unis). Quand elle est évoquée dans les revues professionnelles de l’époque, c’est uniquement pour dénoncer une pratique « odieuse et non scientifique ».
Cet épisode illustre la complexité de la médecine victorienne. Oui, les représentations misogynes ont pesé lourd dans l’imposition de traitements douloureux aux femmes, mais il existe aussi, dès le XIXe siècle, une résistance interne, qui ne doit pas être occultée.
Ce scandale permet également de mesurer l’ancienneté du consentement médical, et du consentement éclairé en particulier, dont les modalités continuent d’être explorées dans le cas de troubles cognitifs, des compétences du malade à consentir ou barrières linguistiques ainsi que face à l’impact de l’utilisation croissante de l’IA dans le processus diagnostique et la décision thérapeutique ; la loi de bioéthique de 2021 introduit ainsi une information obligatoire en cas de recours à l’intelligence artificielle en santé.![]()