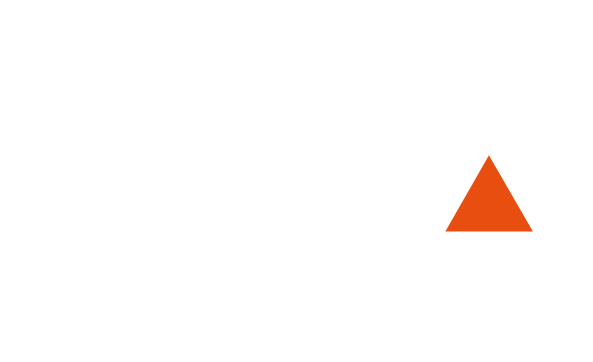Des scientifiques ont trouvé un moyen de choisir le pacemaker le plus adapté à chaque patient, ce qui pourrait permettre de prolonger sa durée de vie de plusieurs années. Des chercheurs de l’Université de Leeds, de l’Université Grenoble Alpes et du Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes, en France, ont mis au point un algorithme qui permet aux médecins de déterminer quelles fonctions d’un pacemaker consomment le plus d’énergie. En fonction des besoins spécifiques de chaque patient, certaines de ces fonctions peuvent être désactivées afin d’économiser la batterie.
Les pacemakers durent généralement de sept à quatorze ans, selon les fonctionnalités utilisées ; désactiver les fonctions non essentielles pourrait donc considérablement allonger la durée de vie de l’appareil. Cela bénéficierait aux patients, en réduisant le nombre d’interventions chirurgicales nécessaires, et permettrait également de diminuer les coûts pour le NHS (le système de santé britannique).
Un article de recherche intitulé
Cardiac implantable electronic devices’ longevity: A novel modelling tool for estimation and comparison a été publié dans la revue PLOS One. L’Université de Leeds l’a rendu accessible en libre accès afin que les médecins du monde entier puissent utiliser gratuitement cet outil de modélisation pour guider leur pratique clinique.
Le
Dr Klaus Witte, maître de conférences et cardiologue au sein de la Faculté de Médecine de l’Université de Leeds et des hôpitaux du NHS de Leeds, déclare :
C’est une première étape pour aider les médecins à décider quel pacemaker choisir et quelles options activer, afin de fournir au patient l’appareil et la durée de vie de batterie dont il a besoin. Cela permettra, espérons-le, de retarder les remplacements de batterie, voire de les éviter complètement — ce qui est bénéfique pour les patients, le NHS et la société dans son ensemble.
Le
Professeur Pascal Defaye, à l’Université Grenoble Alpes et au CHU Grenoble Alpes, ajoute :
Il s’agit d’une approche unique fondée sur des données réelles, qui permet des comparaisons directes entre dispositifs, options et fabricants.
Un pacemaker
est un dispositif implanté qui utilise des impulsions électriques pour maintenir un rythme cardiaque régulier. Il est utilisé pour traiter l’insuffisance cardiaque et certaines arythmies qui peuvent provoquer des pertes de connaissance.
L’appareil, constitué d’un petit boîtier métallique contenant une batterie et un micro-ordinateur, est placé sous la peau près de la clavicule. Des sondes reliées au boîtier sont insérées dans les cavités cardiaques via un vaisseau sanguin. Le pacemaker détecte, grâce à ces sondes, l’activité du cœur et ajoute des battements si nécessaire. Si le cœur ralentit ou omet un battement, le pacemaker envoie une impulsion électrique pour rétablir le rythme normal.
Il existe plusieurs types de pacemakers offrant une gamme de fonctionnalités sophistiquées : régulation d’un rythme cardiaque lent, synchronisation des contractions des cavités du cœur, augmentation du rythme cardiaque lors d’une activité physique, télésurveillance ou encore enregistrement des schémas d’activité. Toutes ces options ne sont pas nécessaires pour chaque patient.
L’équipe de recherche a utilisé les données disponibles dans les manuels des fabricants de pacemakers pour calculer la consommation d’énergie de chaque option. Des modélisations informatiques ont ensuite permis de simuler l’impact de l’activation uniquement des fonctions nécessaires à différents profils de santé. Ces modèles ont été validés à partir de données réelles de patients.
Les résultats ont montré quelles fonctions consommaient le plus d’énergie, comment elles influençaient la longévité de la batterie, et combien d’années supplémentaires pouvaient être gagnées en les désactivant.
Les cardiologues s’appuient généralement sur les informations fournies par les fabricants pour choisir le dispositif le plus approprié à chaque patient. Toutefois, compte tenu de la diversité et de la complexité des modèles disponibles, cette sélection peut être imprécise.
Le
Dr Witte explique :
Nous ne savons pas toujours comment chaque option affecte la durée de vie de la batterie. Le patient et le médecin peuvent désormais discuter ensemble des fonctions indispensables et de celles qui ne sont que des “plus”, ainsi que du coût énergétique associé à chacune.
Choisir le bon appareil et les bonnes options pour un patient peut se comparer à l’achat d’une voiture : on tient compte du coût, des équipements nécessaires et de ceux dont on peut se passer. En combinant cela avec nos précédents travaux montrant qu’une programmation soignée peut prolonger la durée de vie de la batterie, nous nous rapprochons d’une véritable prise en charge personnalisée pour chaque patient.
L’équipe de recherche comprenait également les collègues français
Pascal Defaye (UGA et CHUGA),
Serge Boveda (Clinique Pasteur) et
Jean-Renaud Billuart, ingénieur chez le partenaire industriel Microport.
Article initialement publié par l’Université de Leeds