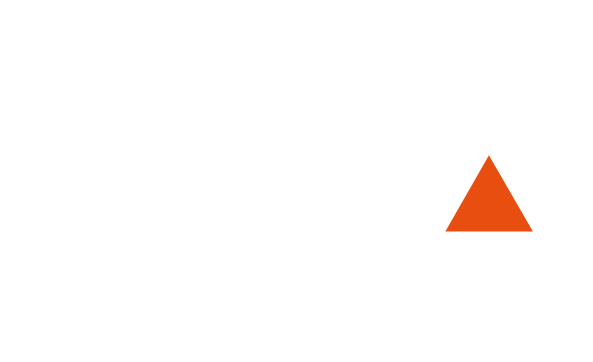The Conversation : "Les femmes sont-elles plus attachées aux animaux que les hommes ?"

Cela crée un petit effet de surprise, car nous sommes habitués à ce que la course à la parité se fasse dans l’autre sens. Pourquoi manquent-ils à l’appel, ceux que l’on croit si disposés à aspirer aux fonctions publiques ? Seraient-ils moins intéressés par la condition animale ? En guise de réponses stéréotypées, des images automatiques viennent à l’esprit : celle du chasseur (98 % d’hommes en France), du boucher (90 % d’hommes), de la végétarienne (67 % de femmes), voire de telle actrice connue pour défendre leur cause. Sans parler des primatologues, qui sont le plus souvent des femmes, à la suite de pionnières comme Dian Fossey, Jane Goodall ou Brigitte Galdigas, et même des universitaires qui se consacrent à l’étude des relations humains-animaux.
Au-delà de ces exemples sélectifs, les hommes se sentent-ils vraiment moins concernés par le sort des animaux ?
L’antivivisectionnisme féminin
L’opposition à l’expérimentation animale est l’un des domaines où les écarts entre les sexes sont les plus documentés. Il s’agit d’une cause où les femmes sont surreprésentées, et dans des proportions qui ont peu évolué depuis 150 ans. Au XIXe siècle, 60 % des leaders antivivisectionnistes étaient des femmes, ce qui représente un chiffre élevé à une époque où celles-ci étaient presque invisibles dans l’espace public. De plus, à cette période, les trois quarts des participants lors de manifestations en faveur des animaux étaient des participantes.
Aujourd’hui encore, l’engagement pour les animaux lors de manifestations publiques reste très féminin : dans neuf études qui comptabilisaient les femmes lors des manifestations pro-animales dans plusieurs pays, elles étaient trois fois plus nombreuses que les hommes.
À l’inverse, lorsqu’il s’agit de violences physiques, ce sont les hommes qui dominent, que les victimes soient humaines ou non. La probabilité qu’une femme adulte frappe gravement un animal est de 39 fois inférieures à celle d’un homme, et celle de lui tirer dessus avec une arme à feu l’est de 45 fois.
Chez les adolescents, une étude française publiée en 2020 et menée par l’un d’entre nous auprès de 12 344 élèves montrait que parmi les 7,3 % qui avaient déjà fait volontairement du mal à un animal, plus des deux tiers étaient des garçons. Il n’existe à notre connaissance aucune culture où les femmes auraient des conduites de violence gratuite plus fréquentes que les hommes avec les animaux. En revanche, on ne manque pas d’exemples ethnographiques où les femmes en prennent soin, et même les allaitent.
C’est aussi les femmes qui se distinguent par une pathologie qui peut être conçue comme une forme subvertie du soin : le syndrome de Noé, cette accumulation compulsive d’animaux qui touche trois fois plus de femmes. Comme en miroir, on constate d’ailleurs que certains animaux domestiques comme les chats s’attachent plus aux femmes qu’aux hommes qui s’en occupent.
Une empathie genrée chez les mammifères
Pour éclairer les différences entre femmes et hommes dans leurs relations avec les animaux, on peut avancer l’hypothèse qu’elle est sous-tendue par des différences dans le degré d’empathie, qui semblent s’appliquer dans de nombreuses espèces en défaveur des mâles.
Dans une vaste synthèse, Leonardo Christov-More, à l’Université de Californie à Los Angeles, a montré qu’en matière de contagion émotionnelle ou d’imitation automatique, les femelles surpassaient constamment les mâles dans diverses espèces.
De plus, chez les gorilles et les chimpanzés, on observe davantage de comportements consolateurs chez les femelles. Chez les gorilles sauvages de l’Ouest, des femelles adolescentes montrent une réaction particulière (entre la curiosité et la peur) vis-à-vis d’un corps sans vie d’un potamochère rencontré sur leur chemin, tandis qu’un’un jeune mâle semblait indifférent à la situation.
Cette préoccupation concernant le sort d’autrui chez les femelles ne semble pas s’arrêter aux primates non-humains. Chez les souris, les femelles sont plus enclines à se tortiller lorsqu’elles voient une autre souris souffrir.
Les femelles de primates non-humains semblent aussi être plus influencées par les comportements des autres membres du groupe. Par exemple, bâiller lorsque des congénères bâillent (une manifestation comportementale bien connue de contagion émotionnelle) se produit plus souvent chez les femelles bonobos.
Chez le choucas, ce sont les femelles qui partagent le plus leur nourriture.
Dans les jeux spontanés, on note aussi plus de conduites de soin : les jeunes femelles chimpanzés sauvages portent davantage des bâtons comme s’il s’agissait de bébés (les mâles s’en servant plutôt pour se taper dessus) ou en captivité elle jouent plus souvent que les mâles avec des poupées si on leur en met à disposition.
Ceci est probablement le résultat d’une prédisposition ou préparations chez les jeunes femelles à la maternité. Chez les primates (ex. macaques, gorilles, etc.), les femelles adolescentes essayent fréquemment de voler des nouveau-nés aux femelles adultes pour tester et apprendre l’art maternel.
Bien sûr, il faudrait étudier de manière systématique ces conduites dans de nombreuses espèces afin de vérifier si elles sont présentes chez la plupart d’entre elles ou seulement dans certaines, et analyser les conditions sociales et écologiques auxquelles ces comportements sont liés. Ceci sera indispensable aussi pour se prémunir d’une évocation sélective de faits qui confirment nos attentes stéréotypiques, qui puisent facilement dans le monde naturel pour se justifier.
Mais de manière provisoire, les travaux disponibles laissent penser que l’empathie est bien plus présente chez les femelles, et qu’elle est probablement un phénomène biologique ancien fondé sur le soin des petits durant la période postnatale.
Pleurs et charité humaine
Tout cela se retrouve chez l’humain. Ainsi, les nouveau-nés de sexe féminin pleurent davantage que les garçons si elles entendent pleurer un autre enfant.
Plus tard, des petites filles de 4 ans qui voient des photos de personnes en détresse ont des réactions plus empathiques que les garçons.
Les écarts d’empathie s’amplifient nettement à l’adolescence, et chez l’adulte, les femmes reconnaissent avec plus d’exactitude les émotions d’autrui, qu’il s’agisse d’expressions faciales, de vocalisations ou de postures. Elles consacrent plus de temps et d’argent à autrui à travers des dons ou un engagement associatif.
Il semble aujourd’hui acquis que les capacités empathiques différencient hommes et femmes, comme l’indiquait cette étude menée sur un échantillon de près de 670 000 participants.
Tuer un animal pour la science
Les différences comportementales entre hommes et femmes ont été récemment confirmées de manière directe lors d’une étude comportementale réalisée à l’Université Grenoble-Alpes. Durant une expérimentation, près de 750 participants de tous les milieux sociaux devaient administrer des doses d’un produit toxique à un animal dans le cadre d’un protocole de recherche pharmaceutique (l’animal était un robot très réaliste, mais ils l’ignoraient). Malgré les signaux de détresse de l’animal, la majorité des participants ont injecté les 12 doses, croyant donc condamner l’animal.
L’observation des comportements a permis de constater que les femmes ressentaient un stress bien plus intense que les hommes et surtout qu’elles administraient moins de doses toxiques en moyenne. Durant l’expérience, quatre participants ont versé des larmes, uniquement des femmes.
Les femmes tueuses existent
Si l’engagement politique dans un parti qui se présente comme celui des animaux attire moins les hommes, serait-ce pour des motifs enracinés dans leur biologie ? Peut-être en partie, mais à condition de ne pas y voir un déterminisme rigide. Il existe de nombreux cas où des hommes manifestent plus d’empathie que les femmes envers les animaux, et par ailleurs, celle-ci découle de dispositions psychologiques individuelles mais est aussi encouragée et canalisée par l’environnement social, qui désigne souvent qui peut en bénéficier.
Ensuite, au moins dans un cas, celui de la chasse au filet chez les pygmées Aka, une chasse coopérative que pratiquent hommes et femmes, ce sont les femmes qui ôtent la vie. Chez ce peuple de la forêt, chasseurs-cueilleurs de la République centrafricaine au cœur de la forêt tropicale, les femmes tuent les céphalophes, ces petites antilopes de forêt que les Akas, hommes et femmes ensemble, chassent au filet (Masi, observation personnelle en 2005 et 2016). Si l’animal est de petite taille (par exemple dans le cas du céphalophe bleu), les chasseuses délèguent même aux plus jeunes, y compris les enfants, la possibilité de gagner de l’expérience à tuer un animal. Les hommes laissent peut-être les femmes tuer ces petites antilopes car il s’agit d’une tâche qui ne requiert pas leur force physique, réservée aux animaux de plus grande taille comme l’éléphant, le buffle de foret, le potamochère, l’hylochère, ou le bongo.
En conclusion, l’existence même exceptionnelle de femmes tueuses d’animaux n’est pas nécessairement une tragédie pour la candidate d’un parti animaliste, même si celles-ci semblent infirmer la figure stéréotypique de la femme empathique et non violente. Elle signifie que la plasticité relative des rôles culturels peut aussi permettre d’envisager que des hommes se dévouent à la cause animale, et que la parité électorale sera peut-être un jour… naturelle.
Mis à jour le 12 mai 2022
Les auteurs
Professeur de psychologie sociale, membre de l’Institut universitaire de France (IUF), directeur de la MSH Alpes (CNRS/UGA)
Université Grenoble Alpes (UGA)
Shelly Masi
Primatologue, Maitre de Conférence du Muséum National d'Histoire Naturelle au Musée de l'Homme et Vice-President de la Société Francophone de Primatologie (SFDP)
Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)
The Conversation
Abonnez-vous !
theconversation.com/fr/newsletter