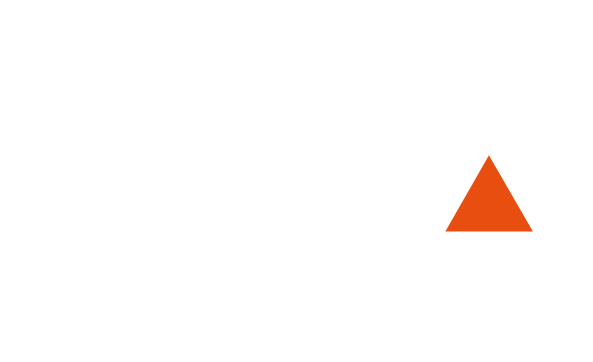Donald Trump veut annexer le Groenland, dans l’apparente indifférence, voire avec l’assentiment de Vladimir Poutine. Le Danemark refuse de céder son territoire autonome, dont les habitants ont récemment porté au pouvoir une coalition dont trois partis sur quatre sont indépendantistes. Au-delà des enjeux liés aux richesses naturelles de l’immense île arctique, ce qui se joue ici, c’est aussi la défense du Groenland, aujourd’hui assurée par les États-Unis dans le cadre de l’OTAN.
En janvier 2025, le président Trump proclame la volonté des États-Unis de prendre le contrôle du Groenland et menace le Danemark, dont l’île est un territoire autonome, de mesures de rétorsion économiques ou militaires si son exigence n’est pas satisfaite.
Ces propos choquent les responsables politiques européens, danois et groenlandais. La posture ouvertement expansionniste de Washington remet en cause le lien transatlantique, et avec lui, l’architecture de sécurité pour le Groenland. En réponse, le ministre français des Affaires étrangères et de l’Europe, Jean-Noël Barrot, mais aussi le président du Comité militaire de l’Union européenne, Robert Brieger, suggèrent dès la fin du mois de janvier l’envoi de troupes européennes au Groenland.
Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !
Ces condamnations unanimes ne suffisent pas à décourager la nouvelle équipe en place à la Maison Blanche. En mars, le projet de visite à Nuuk, la capitale, et Sisimiut, la deuxième ville du Groenland, d’une délégation américaine conduite par le vice-président J. D. Vance, sans invitation officielle, est vivement condamné par les autorités danoises et groenlandaises. Le 26 mars, Donald Trump proclame cyniquement dans le Bureau ovale que le monde a besoin que les États-Unis possèdent le Groenland, et que le Danemark doit céder le Groenland aux États-Unis.
Devant les protestations danoise et groenlandaise, le programme de visite de la délégation américaine est revu à la baisse, mais le symbole reste fort : c’est à la base spatiale américaine de Pituffik que J. D. Vance s’est rendu le 28 mars.
Washington et la défense du Groenland
Jusqu’à présent, ce sont avant tout les États-Unis qui assurent la sécurité du Groenland. Mais il ne faut pas oublier que c’est à la demande de l’OTAN qu’ils gèrent la base de Pituffik (nommée Thulé jusqu’en 2023), depuis l’accord de défense de 1951 signé avec le Danemark – amendé en 2004 pour inclure le Groenland comme partenaire. Cet accord ne remet nullement en question la souveraineté au Groenland du Royaume du Danemark, souveraineté que les États-Unis ont déjà reconnue en 1916.
Ce sont également les membres de l’OTAN qui, avec les exercices Northern Viking, renforcent leur position dans la zone GIUK (Groenland, Islande et Royaume-Uni), qui est devenue une préoccupation stratégique majeure en raison de la projection de puissance navale de la Russie.
Or dans une stupéfiante déclaration faite le 27 mars lors du Forum international de l’Arctique à Mourmansk, Vladimir Poutine a semblé soutenir le projet américain d’annexion du territoire : « Il s’agit, dit-il, de projets sérieux de la part des États-Unis en ce qui concerne le Groenland. Ces projets ont des racines historiques anciennes. » Il précise : « Le Groenland est une question qui concerne deux pays spécifiques. Cela n’a rien à voir avec nous. »
Le rapprochement économique souhaité par Moscou et Washington dans le contexte des négociations sur la guerre en Ukraine pourrait-il avoir des ramifications dans l’Arctique ? Kirill Dmitriev, conseiller du président Poutine pour les investissements étrangers et la coopération économique, affirme : « Nous sommes ouverts à une coopération en matière d’investissement dans l’Arctique. Il pourrait s’agir de logistique ou d’autres domaines bénéfiques pour la Russie et les États-Unis. » « Mais avant de conclure des accords, ajoute-t-il, il faut que la guerre en Ukraine prenne fin. »
L’implication croissante du Groenland dans sa sécurité
La première ministre danoise, Mette Frederiksen, veut croire que le lien transatlantique reste solide. Cependant, si l’affaiblissement de ce lien soulève des questions sur la sécurité du Groenland, la marche du territoire autonome vers l’indépendance introduit un autre facteur.

La sécurité du Groenland est inévitablement déterminée par sa relation avec l’ancienne puissance coloniale. Aujourd’hui, le Groenland est autonome dans plusieurs domaines de l’administration, mais la sécurité et la défense notamment restent du ressort du Danemark. Cependant, le gouvernement groenlandais, le Naalakkersuisut, souhaite de plus en plus être impliqué dans les prises de décision relatives à ces domaines. Espérant des retombées économiques et la valorisation des savoirs locaux, il aspire à prendre progressivement en charge certains aspects de la politique de sécurité.
Le territoire autonome a été consulté pour la première fois de façon significative sur les questions de défense lors de la mise en place de l’accord de défense conclu le 27 janvier 2025 entre le gouvernement du Danemark et les partis représentés au Parlement danois, d’une valeur de 2 milliards d’euros. L’accord entend améliorer la surveillance, l’affirmation de la souveraineté et la résilience sociétale dans la région, soutenir les alliés et la mission de l’OTAN. Les parties veulent également renforcer la coopération en matière de renseignement et de recherche et moderniser les installations du Commandement conjoint de l’Arctique à Nuuk. À cet effet, trois nouveaux navires de patrouille arctique sont prévus.
Dans ce contexte, les résultats des élections législatives tenues au Groenland le 11 mars signalent un désir marqué pour un développement économique renforcé permettant l’accès à l’indépendance.
Un nouveau gouvernement dans un moment critique de l’histoire du Groenland
Les deux partis qui ont dominé la vie politique du Groenland depuis 50 ans, le parti écologiste de gauche Inuit Ataqatigiit (IA) et le parti social-démocrate Siumut, ont vu leur soutien combiné chuter de moitié au profit du parti de centre droit Demokraatit (29,9 % des voix), favorable à une politique économique libérale au Groenland, en particulier pour le secteur de la pèche, et du parti nationaliste populiste Naleraq (24,5 %). Comme tous les partis groenlandais à l’exception d’Atassut (parti libéral-conservateur ayant récolté 7,5 % aux dernières législatives), Naleraq souhaite l’indépendance du Groenland mais il revendique une indépendance immédiate. La large coalition gouvernementale formée le 27 mars réunit les partis Demokraatit, Inuit Ataqatigiit, Siumut et Atassut, mais elle exclut Naleraq, une décision qui traduit la volonté de ne pas fragiliser le devenir du Groenland à un moment où Washington martèle sa volonté de mettre la main sur l’île.
Durant sa campagne, le parti Demokraatit a insisté sur le fait que le Groenland n’était pas à vendre, tout en souhaitant une indépendance du Groenland soutenue par un accord de libre association avec le Danemark ou avec les États-Unis. La libre association désigne des accords internationaux entre de petits États et une grande puissance qui leur garantit sécurité, défense et aide financière significative, comme le Traité de libre-association de 1986, qui régit les relations entre les États-Unis et des micro-États du Pacifique comme la Micronésie, les îles Marshall et les Palaos. Cette option semble avoir fait long feu alors que des manifestations anti-américaines se déroulent devant le Consulat des États-Unis à Nuuk. IA et Siumut recommandent une participation à l’OTAN en complément de la défense nationale danoise, IA précisant que le Groenland pourrait siéger au sein de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN.
La majorité des femmes et des hommes politiques du Groenland cherchent un partenariat en matière de sécurité qui complémente celui qui existe entre le territoire autonome et le Danemark. Ce désir d’un arrangement post-colonial se reflète aussi clairement dans la recherche d’une diversification des partenaires économiques avec, par exemple, l’Islande, le Royaume-Uni, les États-Unis et les pays asiatiques. L’Union européenne n’apparaît pas de façon saillante dans les propositions des partis politiques, peut-être en raison des accords déjà signés en vertu du Traité du Groenland de 1985 qui associe le Groenland et l’UE. L’UE verse chaque année 13,5 millions d’euros au Groenland pour qu’il ouvre ses eaux aux navires de pêche de l’UE, et 3 millions d’euros pour soutenir la pêche durable. À cela s’ajoutent 225 millions d’euros pour la période 2021-2027 afin de soutenir l’éducation et la croissance verte.
En ce qui concerne les matières premières, l’UE et le Groenland ont signé en novembre 2023 un accord de partenariat stratégique, sous la forme d’un protocole d’accord visant à établir des chaînes de valeur durables pour les matières premières. Naaja H. Nathanielsen, alors ministre des affaires étrangères, du commerce, des ressources minérales, de la justice et de l’égalité des genres du Groenland, a indiqué que cet accord serait soutenu par une feuille de route afin de garantir des résultats concrets profitant aux deux parties, mais que l’UE devait encourager les États membres à investir.
En termes de défense et de sécurité, les options du Groenland ne sont pas si variées. Outre le fait de compter sur les États-Unis et le Danemark, elles consistent en deux possibilités non exclusives : l’OTAN et la défense européenne.
Des scénarios limités nécessitant l’accord du Groenland
Pour les Groenlandais qui veulent être maîtres de leur destin, toute dépendance exclusive à l’égard des États-Unis est problématique. Selon un récent sondage, 85 % d’entre eux s’opposent à la politique américaine en la matière.
S’appuyer exclusivement sur l’OTAN pourrait également être une décision incertaine. Si les États-Unis se retirent de l’OTAN, comme Trump l’a menacé à plusieurs reprises, la légitimation de leur gestion de la base de Pituffik disparaîtrait. Et si les États-Unis ne constituent plus une assurance fiable contre la projection de la puissance navale de la Russie et ses menaces hybrides, mais menacent plutôt le Groenland lui-même comme ils le font de façon insistante, les partenaires européens et les capacités de l’Union européenne entrent en jeu. Les États qui ont participé aux exercices Northern Viking - la Norvège, le Royaume-Uni et la France - deviendraient certainement des acteurs plus importants, de même, possiblement, que l’Islande, qui certes n’a pas de forces armées propres mais représente un « porte-avions insubmersible ».
Quelles que soient les options retenues, elles ne seront pertinentes pour la sécurité du Groenland que si elles sont choisies librement par le peuple groenlandais. Entre la menace de l’expansionnisme américain et le contexte post-colonial, c’est peut-être l’UE, avec sa structure juridique et ses valeurs, qui pourrait offrir aux Groenlandais la meilleure chance de déterminer leur sécurité selon leurs propres termes.![]()