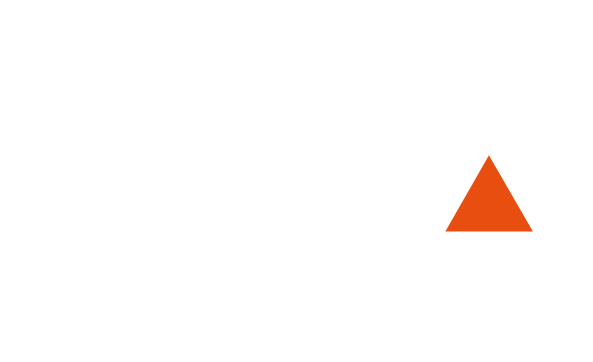En consacrant la notion de « harcèlement moral institutionnel », la plus haute juridiction française reconnaît définitivement que la responsabilité pénale d’une entreprise et de ses dirigeants peut être engagée lorsqu’une politique managériale, menée en connaissance de cause, a pour effet de dégrader les conditions de travail des salariés.
L’arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 2025 condamne définitivement sept dirigeants, mais aussi la personnalité morale de France Télécom au titre d’un « harcèlement moral institutionnel » résultant de la politique de l’entreprise. Avec cette nouvelle notion, la responsabilité pénale d’une société et de ses dirigeants peut désormais être engagée lorsqu’ils ont mis en œuvre, « en connaissance de cause », une politique d’entreprise ayant pour « objet » ou pour « effet » une dégradation des conditions de travail des salariés.
Au début des années 2000, le PDG Didier Lombard lance en effet le plan Nouvelles Expériences des Télécommunications (Next), qui prévoyait 22 000 départs en trois ans, soit 20 % de départs parmi les salariés ayant le statut de fonctionnaire. Sans procéder à des licenciements classiques, l’entreprise imagine alors une politique visant à précipiter les départs.
Les différents niveaux de l’encadrement installent un climat de pressions constantes, effectuent des réorganisations permanentes et abusives, des mutations forcées ou des mises à l’isolement. Les brimades de salariés sont fréquentes. Entre 2008 et 2011, plus de soixante employés se suicident, et quarante tentent de mettre fin à leur jour. Ce plan Next sera d’ailleurs qualifié par la presse de « plan de l’éradication ».
L’arrêt consacre la notion de harcèlement moral institutionnel
En pratique, cet arrêt vient ainsi consacrer la notion même de harcèlement moral institutionnel. Comme le rappelle Michel Miné, le harcèlement moral institutionnel « figure désormais au plus haut niveau de la jurisprudence […] un grand arrêt de droit pénal, mais aussi de droit du travail ».
Complétant le droit relatif au harcèlement moral, cette évolution a une portée considérable pour les salariés de toutes les organisations, mais également pour leurs directions et leurs responsables RH. Ces derniers sont désormais pénalement responsables des effets de leurs politiques. C’est donc un nouvel univers de la santé au travail qui s’ouvre potentiellement.
L’arrêt concerne aussi les situations antérieures à 2025
En s’appuyant principalement sur les travaux parlementaires relatifs à la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, la rédaction de cet arrêt de la Cour de cassation inscrit dans le droit deux ouvertures à très forte portée progressiste. Ces ouvertures répondent précisément aux attentes des salariés dont la santé s’est détériorée du fait de politiques organisationnelles ou managériales. Michel Miné résume très bien cette évolution en notant que
« le juge n’est pas là pour juger des choix stratégiques, mais pour examiner les effets des méthodes de gestion qui en découlent ».
À la suite de cet arrêt, un tribunal administratif sera désormais légitime pour « déterminer si la méthode employée pour mettre en œuvre la politique d’entreprise excède le pouvoir normal de direction et de contrôle du chef d’entreprise » (§70). Tout n’est donc plus possible au seul motif que c’est la liberté d’entreprendre qui appelle des choix stratégiques d’entreprise… non discutables. En matière de santé au travail, le choix de gestion dans l’organisation ne bénéficie plus d’une totale immunité : il peut être jugé.
Ensuite, cet arrêt crée, à côté du harcèlement moral déjà défini par l’article L.1152-1 du Code du travail, une forme de harcèlement moral sans qu’une relation entre des personnes individuellement identifiées soit nécessaire. Sans nécessité d’une action d’une personne sur une autre, le harcèlement moral institutionnel peut être exercé à l’égard « d’autrui » (terme de l’arrêt). Sans besoin de prouver un ciblage individuel, le harcèlement peut donc indifféremment concerner une équipe, un service, un groupe de salariés et, par extension, l’ensemble des membres d’une organisation. En fait, « pourvu que ces dernières fassent partie de la même communauté de travail et aient été susceptibles de subir ou aient subi les conséquences » de la politique managériale (§40).
Les conséquences de cet arrêt sont en réalité aussi vastes que profondes. Première conséquence de l’arrêt de janvier 2025, des situations antérieures à 2025 sont concernées. Il est en effet considéré que cette évolution du droit était « prévisible » de sorte qu’elle peut s’appliquer à des faits antérieurs.
Toutes les politiques managériales dysfonctionnelles ou pathogènes sont concernées
Si la temporalité est étendue, le champ l’est aussi. En condamnant également la personne morale France Télécom, la Cour de cassation étend potentiellement le champ à toutes formes d’organisation : de la TPE à la collectivité territoriale en passant par l’hôpital ou l’université, toutes les politiques managériales dysfonctionnelles ou pathogènes sont potentiellement concernées.
Cette nouveauté est intéressante : les organisations publiques et bureaucratiques sont en effet particulièrement sujettes à ces politiques aux effets dévastateurs et peu abordés, comme nous l’avons montré ailleurs à partir de la pratique du harcèlement en meute.
Ainsi, dans les mois qui viennent, les premiers jugements de différentes juridictions vont être connus et discutés. Le juge administratif sera particulièrement scruté pour connaître son degré de suivisme de l’arrêt de la Cour de cassation ; juridiction qui représente le plus haut niveau de jurisprudence : va-t-il vraiment suivre l’arrêt qui consacre le harcèlement moral institutionnel et, ainsi importer ce délit dans l’environnement public ?
L’égalité devant la loi devrait imposer que ce type de décision soit également adoptée par les juridictions administratives. Il semble assez probable que le juge administratif suive cette voie, avec toutefois quelques modulations. Un premier arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux en avril 2025 va dans ce sens. Ainsi, la jurisprudence pourrait par exemple, amener à condamner une université pour « faute de service » en cas de harcèlement moral institutionnel. Le juge devra au fond arbitrer entre un jugement mettant en avant la « responsabilité pour carence » (manquement à l’obligation de protéger les agents) ou « une qualification pénale ». Si rien n’est encore joué sur le sens de cet arbitrage, il n’en demeure pas moins que le temps de l’impunité semble révolu : les victimes peuvent désormais agir sur le terrain pénal contre l’institution elle-même, en complément des recours en droit du travail ou administratif.
Deuxième conséquence, le périmètre des acteurs impliqués et l’incidence sur leurs responsabilités sont en définitive précisés par cet arrêt de janvier 2025. C’est surtout leur mise en cause pénale qui est mise en lumière.
Dit simplement, si une politique managériale promeut, en connaissance de causes, des méthodes de gestion pathogènes pour la santé des salariés, tout dirigeant, mais aussi tout cadre actif dans la promotion de cette politique peut être jugé responsable. La Cour de cassation signale ainsi, dans son arrêt de janvier 2025, le « suivisme » des directions et services de ressources humaines (DRH) dont « les procédures et les méthodes ont infusé dans toute la politique managériale ». Fait majeur, une DRH est potentiellement « complice du délit » de harcèlement moral institutionnel quand elle accompagne des politiques pathogènes dont les effets sont connus.
Au minimum, une vigilance accrue est donc attendue des DRH en matière d’adoption de méthodes de gestion afin de ne pas être dans l’abus immanquablement porteur de risque pénal. Plus largement, la posture professionnelle de la DRH est sérieusement questionnée : connaissant l’objet ou les effets d’une politique sur la santé des salariés, doit-elle toujours accompagner sa direction, dont elle dépend de manière souvent très étroite ? Si la DRH a par exemple connaissance de la volonté d’un dirigeant de cibler un ou plusieurs salariés, au point que des atteintes à leur santé soient envisageables, quelle doit être sa posture ou son éthique, pour reprendre une notion chère à la communauté des responsables de ressources humaines ?
Vers une responsabilité de tous en matière de santé au travail ?
Par enchaînement, il est possible de tracer des perspectives au regard de ce nouvel état des lieux des responsabilités quand un harcèlement moral institutionnel est avéré pour le juge.
Comment évaluer, par exemple, la responsabilité des élus de conseils des collectivités publiques, des élus d’un conseil d’administration d’universités, d’hôpitaux ou d’associations dès lors qu’ils marquent une trop grande complaisance vis-à-vis de la poursuite de politiques managériales dont ils ont à connaître les effets sur la santé des salariés ? Ne sont-ils pas, comme « organes de décisions » partie prenante des atteintes à la santé, comme l’ont été des cadres de France Télécom ?
Naturellement, le même questionnement peut être adressé aux représentants du personnel et à leur posture. Pour la plupart d’entre eux, ils ont évidemment chevillé au corps le souci de documenter les atteintes à la santé des salariés liés au management du travail et d’accompagner les salariés en souffrance, y compris pas l’outil juridique. L’affaire de France Télécom est d’ailleurs emblématique du rôle exemplaire des représentants syndicaux. Ils ont consciencieusement mobilisés les dispositifs légaux prévus à cet effet dans les organisations (les outils de la commission Santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), notamment).
Une interrogation demeure pourtant : quelle est la responsabilité de représentants des salariés qui, par complaisance, faiblesse, intérêt ou connivence avec les directions, minimisent ou ignorent l’importance de la prise en charge cette nouvelle question du harcèlement moral institutionnel ? Dans l’affaire France Télécom, les élus CFDT et FO étaient par exemple dans « un déni de la situation » selon le syndicat Solidaires, acteur central de la démarche d’accompagnement et de dépôt de plainte. N’oublions pourtant jamais que « l’homme est responsable de son ignorance, l’ignorance est une faute », pour Milan Kundera.
Pour le citoyen-salarié, avec la reconnaissance juridique du harcèlement moral institutionnel, une nouvelle étape est sans nul doute franchie : le temps de l’impunité des directions et du management semble en tout cas révolu, quelle que soit l’organisation concernée. Tout montre que le citoyen-salarié peut donc se sentir un peu moins seul face à ses éventuelles souffrances, comme ce fut déjà le cas avec la reconnaissance juridique du « harcèlement moral », en 2002, à la suite des travaux pionniers de Marie-France Hirigoyen et de Christophe Desjours.
En définitive, le premier défi de la caractérisation juridique de cette nouvelle facette du harcèlement moral semble maintenant relevé. Si les faits sont donc assez documentés, notamment par les représentants du personnel, le juge peut travailler. Encore faudra-t-il, in fine, que les différentes juridictions fassent demain écho, dans un délai raisonnable, à cette immense attente de justice face aux errances de directions et de manageurs aux politiques déviantes et pratiques toxiques, toutes porteuses de profondes souffrances au travail, souvent inaudibles. C’est le prochain défi de santé au travail qui est devant nous.![]()